La protection des sites
Textes règlementaires - rôle de la DREAL

La protection au titre des sites
La loi du 21 avril 1906 constitue le plus ancien texte législatif s’intéressant à la conservation des paysages et monuments naturels. Dans un contexte de prise de conscience de la fragilité des paysages face aux excès de l’industrialisation, elle encadre la protection des monuments naturels en vue de les sauvegarder.
La loi du 2 mai 1930 clarifie l’application de la loi initiale de 1906 et la complète en élargissant les critères de protection. Elle prévoit la possibilité d’inventorier les lieux dont le caractère exceptionnel justifie une reconnaissance et une protection par la nation. Cette loi fondatrice a été codifiée en 2000 dans le code de l’environnement aux articles L341-1 et suivants.
Ce corpus réglementaire vise à préserver de toute atteinte grave (destruction, altération, banalisation) les monuments naturels et les sites. Après classement, les sites constituent un patrimoine national protégé où est instituée une servitude d’utilité publique entraînant le contrôle de tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du site par une autorisation spéciale de l’État.
Les protections réglementaires ont pour but de transmettre ces paysages remarquables en bon état aux générations futures
Le code de l’environnement attribue deux niveaux de protection aux paysages exceptionnels :
Les sites inscrits
Ils présentent un intérêt qui justifie une vigilance de l’État, sans qu’il soit nécessaire de recourir au classement. Conformément à l’article L.341-1 du code de l’environnement, les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’architecte des bâtiments de France (ABF), quatre mois avant leur lancement. L’ABF formule un simple avis consultatif, sauf pour les permis de démolir pour lesquels l’avis est conforme.
Les sites classés
Ils sont les sites parmi les plus remarquables. Leur caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis, selon leur nature, à autorisation préalable du préfet ou du ministre chargé des sites. Dans ce dernier cas, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) est préalablement requis.
Les travaux et aménagements en site classé
Guide à télécharger :
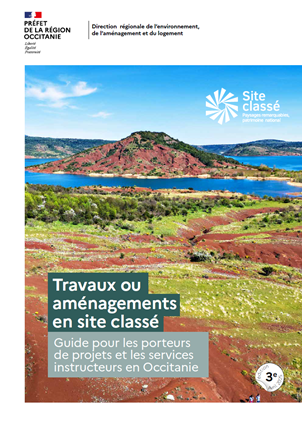
Une politique publique du ministère de la Transition écologique
Elle vise à préserver des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général du point de vue artistique (c’est-à-dire ayant fait l’objet d’une ou plusieurs œuvres d’art), historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (c’est à-dire digne d’être peint).
Au fil des décennies, cette politique est passée de la protection de sites ponctuels à celle de grands ensembles paysagers, et d’une politique de conservation pure à une gestion dynamique des sites. Elle a inspiré la politique du patrimoine mondial de l’UNESCO. La France compte 2 700 sites classés et 4 800 sites inscrits soit 4 % du territoire national.
Les sites classés et inscrits, élevés au rang de patrimoine national, sont parmi les monuments naturels et paysagers les plus remarquables de France.
Retrouvez l’article relatif à cette politique publique sur le site internet du Ministère, et notamment la brochure intitulée : Les sites classés - Protéger et transmettre notre patrimoine paysager
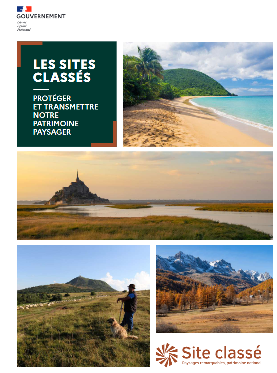
L’inspection des sites
Pour ce qui relève des travaux susceptibles de modifier l’aspect des sites classés, la mission des inspecteurs des sites de la DREAL se décline en trois volets :
- l’accompagnement des pétitionnaires dès l’étape de la conception du projet, avant le dépôt du dossier, dans l’objectif de concilier leurs besoins avec les exigences de préservation de la qualité paysagère du site ;
- l’instruction des dossiers de demande de travaux, en lien avec l’ Unité Départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) ;
- les actions de contrôle pour s’assurer de la bonne application de la réglementation. Les infractions constatées dans le cadre de l’inspection des sites ou par des tiers font l’objet des procédures de police administrative et/ou judiciaire prévues par le code de l’environnement. Les inspecteurs des sites peuvent également être amenés à constater la bonne exécution des travaux préalablement autorisés.
Contacts
| Ariège (09) | Pierre Lehimas | ||
| Aude (11) | Marine Jourdren | ||
| Aveyron (12) | Agnès Simonin | ||
| Gard (30) | Aurélie Harnéquaux | ||
| Haute-Garonne (31) | arrdt de Toulouse arrdt de Saint-Gaudens arrd de Muret |
Alain Guglielmetti Pierre Lehimas Ludivine Vanduick | |
| Gers (32) | Isabelle Jardin | ||
| Hérault (34) | arrdt de Lodève arrdt de Montpellier et Béziers |
Juliette Cauvin Grégoire Lagny | |
| Lot (46) | Geneviève Sasia | ||
| Lozère (48) | Martine Gendre | ||
| Hautes-Pyrénées (65) | Eleonore Seigneur | ||
| Pyrénées-Orientales (66) | Bertrand Florin | ||
| Tarn (81) | Corinne Kron-Ramirez | ||
| Tarn-et-Garonne (82) | Ludivine Vanduick | ||
| Canal du Midi | quel que soit le département | canal-du-midi.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr |
Sur le même sujet
Labellisation du Grand Site de France de la Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian
Le label Grand Site de France a été attribué le 19 décembre 2025 à la Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian, par décision ministérielle
5 janvier 2026
Séminaire « habiter les paysages, vers la planification écologique » - 11 juin 2024 - Narbo Via
Séminaire traitant de la planification écologique sur les trois types d'espaces anthropisés que sont les milieux urbains, les milieux péri-urbains (…)
13 février 2025
Séminaire Paysage et changement climatique - 14 juin 2023 - Narbo Via
Séminaire d'échange sur la démarche paysagère au service du territoire dans une perspective d'adaptation au changement climatique.
27 novembre 2023